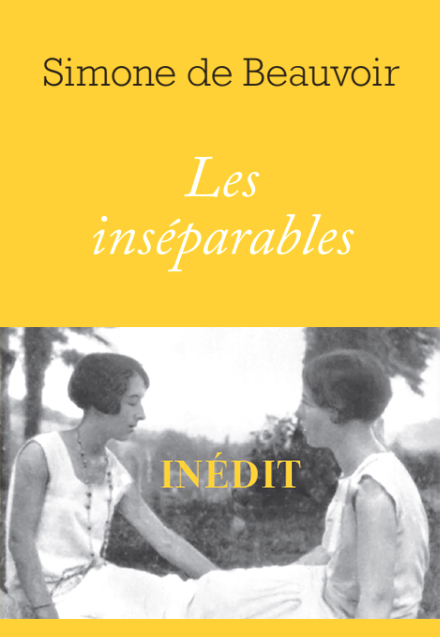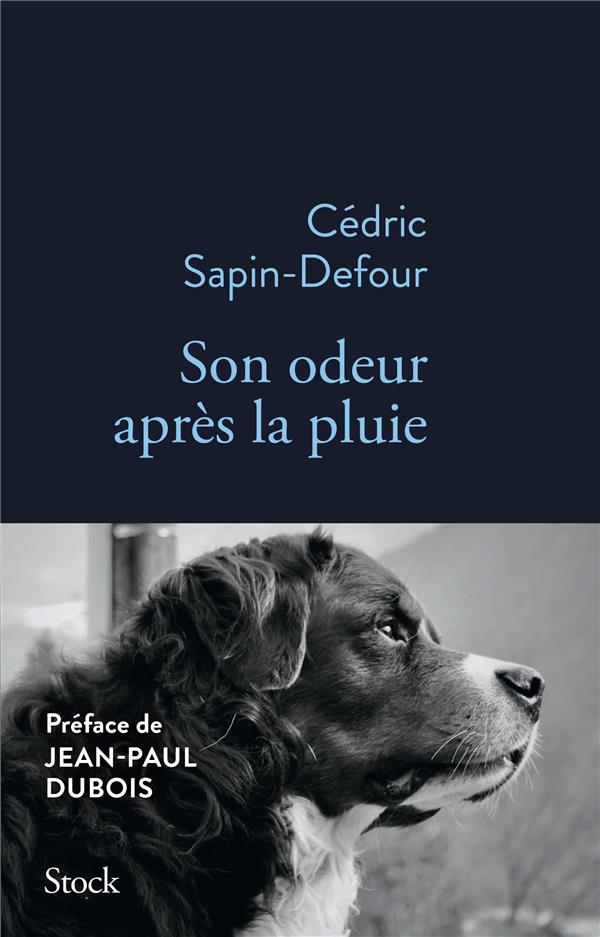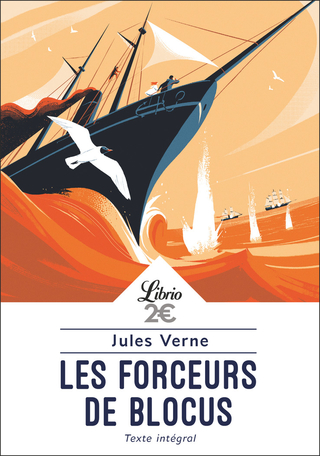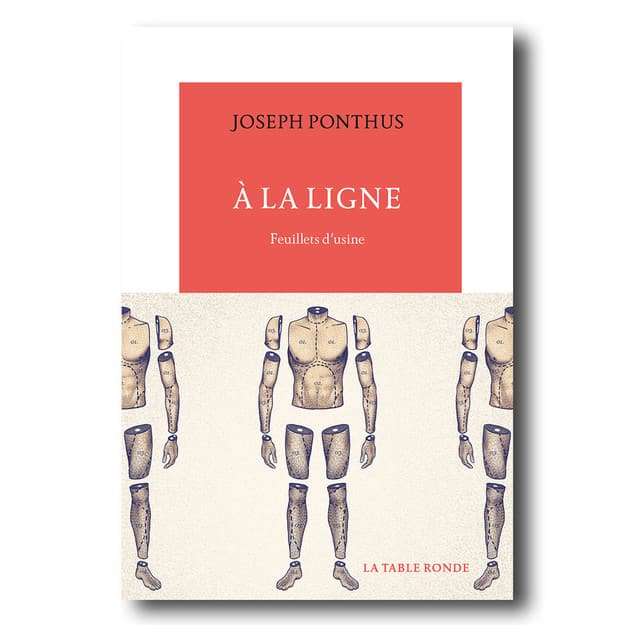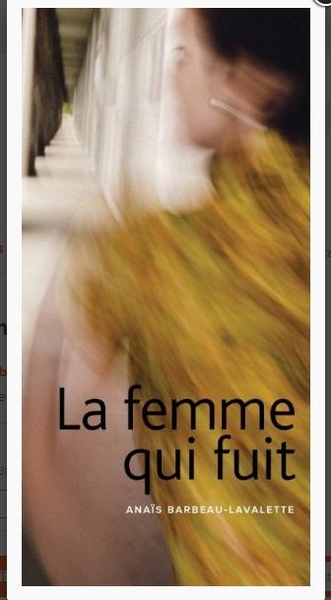En 2029 a eu lieu la Revenge Week : une partie de la population française a décidé de punir les criminels sans passer par la justice, au fonctionnement trop long et inefficace. Suite à ce mouvement révolutionnaire où chaque Français prend ses responsabilités, des maisons de verre ont été construites afin de surveiller tout le monde, l’ère de la « Transparence citoyenne » a démarré... En 2049, une famille, les Royer-Dumas, disparaît : Rose, Miguel et leur garçon Milo. Un fait assez rare et incompréhensible puisque les voisins voient constamment dans les maisons des autres, s’épiant sans cesse. Hélène, la narratrice, une ancienne flic, enquête.
Vous l’aurez compris, c’est une dystopie qui interroge sur quelques thèmes qui nous menacent et nous préoccupent déjà aujourd’hui : le besoin de transparence, les failles de la justice, l’omniprésence des réseaux sociaux. Grâce à ces maisons-vivariums, il y a bien moins de violences conjugales, de viols, d’enfants battus, d’agressions, ... mais encore beaucoup plus de mensonges, de cachotteries et de faux-semblants. Dans cette nouvelle DDR, l’extrême vigilance de tous les instants n’a cependant pas empêché le crime. L’enquête qui piétine est complètement bancale, le rythme tout aussi irrégulier, les personnages souvent à peine dessinés. L’ensemble est poussif, on nous rappelle par mille détails dans quel univers nous sommes et le côté répétitif m’a agacée. Je n’ai pas été convaincue par ma lecture (Prix Renaudot des Lycéens 2023...), je n’ai pas adhéré à ce monde transparent qui ne m’a pas paru crédible un instant. Des maladresses de ponctuation (comme dans l’extrait ci-dessous) et de style n’ont pas non plus arrangé mes affaires.
Manou a, elle, été complètement emballée, je vous laisse lire son billet bien plus complet que le mien.
« La maison d’en face est moins bigarrée. C'est un cube translucide dans lequel vit un couple sans enfants : Lou et Nadir. Je suis arrivée à l'heure où ils faisaient l’amour. Pour préserver un minimum d'intimité, certains couples ont investi dans des lits-sarcophages. Le principe est simple : chacun à son tour appuie sur le déclencheur - ce qui garantit le consentement - et le lit se referme comme une boîte. En cas de problème, un bouton d'urgence à l'intérieur permet d'ouvrir le coffre et d'alerter les gardiens. »
Il n’y a presque plus de livres dans ce nouveau monde : « On préfère désormais les tablettes numériques, plus légères, plus pratiques. Surtout, elles permettent de lire la dernière version en date d'un ouvrage : depuis que les auteurs peuvent retoucher leur texte après publication, le livre n'est plus cet objet poussiéreux, figé dans le passé, il évolue, s'adapte à l'époque. Les maisons d'édition ont même recruté des modérateurs professionnels, chargés de retravailler et de nettoyer certains passages à la place de l'auteur. Trois versions d'un même ouvrage (une version brute, pour les universitaires, une version abrégée, pour les impatients, et une version normalisée, pour les plus sensibles) sont aujourd'hui disponibles grâce aux nouvelles tablettes. »