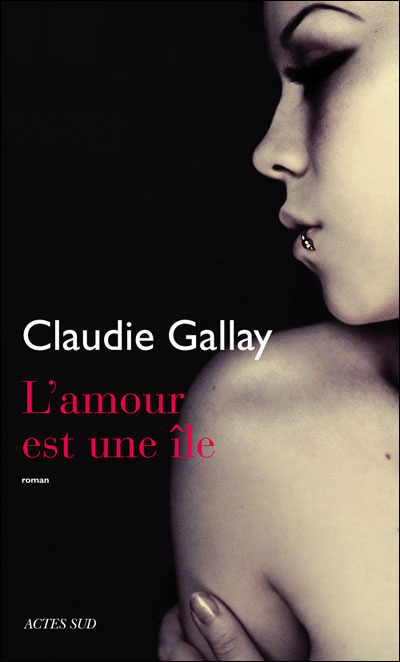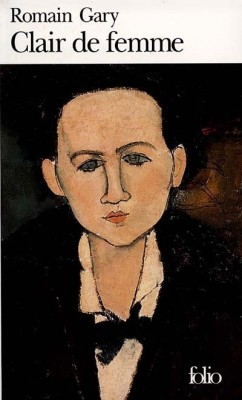Benacquista est mon chouchou parmi mes préférés. J’avais eu un réel coup de cœur pour Quelqu’un d’autre, j’ai vraiment aimé Malavita puis j’ai presque tout lu de lui, BD comprises (ici ou là) Pour honorer le Découvrons un auteur chez Pimprenelle du mois de septembre, j’ai dû trouver une œuvre que je n’avais pas encore lue… Il en restait quatre dont la dernière parution qui ne me tente pas, pour l’instant. 
C'est donc dans un gros pavé intitulé simplement Quatre romans noirs que j'ai trouvé mon bonheur.
Antoine est un quidam un peu solitaire. Son métier consiste à accrocher et démonter les toiles et œuvres d’art de diverses expositions. Son boulot fini, il file assouvir sa passion : le billard. Cette routine tranquille se brise un jour où un cambrioleur vient déchirer au cutter une mystérieuse toile de la « Rétrospective Etienne Morand ». Antoine s’interpose, reçoit un coup de cutter dans la joue puis s’évanouit. A son réveil, le cauchemar est total puisqu’il se rend compte qu’il lui manque la main droite : elle a été sectionnée et réduite en bouillie par une énorme sculpture qui est tombée sur Antoine juste après l’agression. Tout en tentant de vivre sans main droite et en pénétrant dans le monde des manchots, Antoine mène l’enquête : pourquoi cette œuvre ? Il s’agit d’une « jaune » qui certes s’oppose au reste de l’exposition composée d’œuvres « noires ». Sans le savoir, Antoine a mis le pied dans un engrenage diabolique. Guidé par la vengeance, cet ancien champion de billard fera tout pour dévoiler la vérité. Filature, planques, menaces, agressions et entrée suspecte dans l’univers de l’art lui permettent d’arriver à ses fins.

J’ai retrouvé tout ce que j’aime chez Benacquista : le cynisme, la dérision, la maîtrise du réalisme, le suspens froid et prenant. Je me suis engouffrée dans cette sombre histoire avec délectation, apercevant un pan particulier de l’art contemporain et découvrant un autre art, celui du billard. Un point de détail amusant : Antoine, parallèlement à sa sordide mission qu’il s’est lui-même allouée, a acheté une machine à écrire pour expliquer sa nouvelle situation d’infirme à ses parents. Il tape laborieusement de sa main gauche, déchire, refait un brouillon… deux exemple :
« Chers vous deux. Imaginez une partie du corps humain qui n’existe pas, une extrémité ronde et lisse qu’on jugerait à s’y tromper parfaitement naturelle. Mettez-la exactement à l’endroit où habituellement on trouve une banale main. C’est mon moignon. »
« Chers vous deux. Je ne vous ai pratiquement jamais écrit, et le sort a voulu que, si j’en prends la peine, aujourd’hui, ce n’est que d’une seule main. »
Et un extrait où Antoine épie un peintre de grand talent, Linnel : « Accroupi, devant, figé comme un animal qui va mordre, je l’ai enfin repéré. Lui. Linnel. A pied d’œuvre. Il a presque fallu qu’il bouge pour que je puisse identifier un corps humain au milieu de ce cataclysme bariolé. Il l’est presque jusqu’au cou, lui aussi, avec son tee-shirt blanc et son jean suintant de vert et de noir. J’ai bien compris, il cherche à se confondre avec le reste. Tactique de caméléon. Il a cru m’échapper, camouflé, immobile, perdu dans la luxuriance de son travail. Il reste accroupi, totalement seul, à des milliers de kilomètres de mes yeux, tout tendu et aimanté vers l’espace blanc. Tout à coup il s’allonge entièrement dans la mélasse des journaux et renverse un verre d’eau, sans y prêter la moindre attention. Et se relève, d’un bloc, pour tremper un pinceau dans un pot bavant de jaune.»