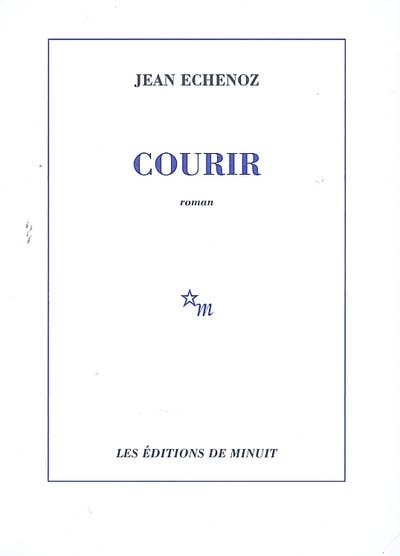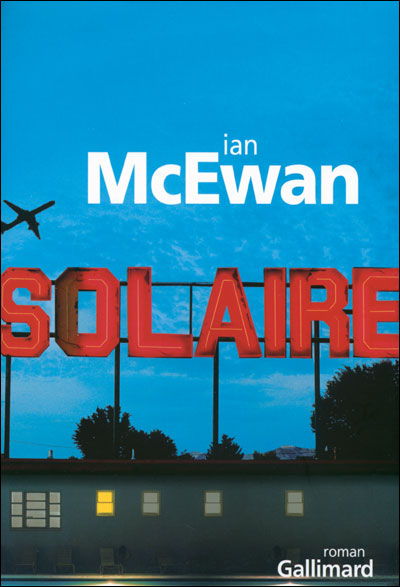C’est emportée par l’engouement de Jérôme et pourtant un peu refroidie par la rentrée littéraire (qui m’a peu inspirée) que j’ai acheté ce livre.
C’est l’histoire d’un gars… ouais, c’est l’histoire de Gérault que tout le monde appelle par son nom de famille. Alors qu’il vient de se faire virer de sa boîte, il attire pitié et compassion autour de lui. Jean-Yves l’invite chez lui, lui présente sa femme que le narrateur surnomme vite « Heinchérie » et lui propose du boulot dans l’épicerie de son neveu. Oui, mais le neveu pourrait être le fils de Gérault et c’est un blanc-bec arrogant.
Rajoutez à cela que notre Gérault est célibataire depuis trop longtemps, qu’il a le ventre qui forme la lettre D, au mieux la lettre B quand il le rentre, qu’il ne veut pas de sa Françoise trop vieille et trop molle qui lui court après et qu’il ne sait pas dire non à une mère envahissante, égoïste et manipulatrice ! On obtient un être aigri qui ne sait pas s’affirmer, n’est jamais satisfait, n’ose pas prendre d’initiatives… un looser, quoi ! Pourtant, la Françoise qu’il trouvait trop joyeuse et trop vieillotte va lui montrer qu’elle est plus fine et plus intelligente que lui.
On commence ce roman et on tombe tout de suite et plutôt lourdement dans un style un peu primitif qui, à l’image du personnage, se complaît constamment dans une attitude ironique et attentiste. Le monologue intérieur crée sans cesse un décalage entre ce que pense Gérault et ce qu’il dit ou fait. Malgré les surnoms un peu faciles (« jeune con » pour le neveu chef d’entreprise, « Mme Gros-Yeux » pour celle qui surveille la maman de Gérault), notre JeanPierreBacri nous fait vite comprendre qu’on lui ressemble un peu, à juger notre entourage sans pour autant assumer à 100% ce qu’on est, à culpabiliser à la moindre parole blessante d’un proche, à bafouiller, à douter… Cet ours mal léché devient, sous la plume corrosive et paradoxalement tendre de l’auteur, incroyablement humain ! La fin est une très belle réussite et une petite leçon d’humanité. L’ensemble est souvent drôle et terriblement actuel. J’ai donc passé un bon moment avec ce Gérault que je ne souhaite pas forcément rencontrer …
Pour la petite histoire, j’ai l’habitude d’user et d’abuser des marques d’ironie à tel point que ma fille (5 ans ½) doit souvent me demander « C’est ironique, maman ? »
Gérault rencontre la mère d’une amie, et surtout son grain de beauté : « La bouche fuchsia s’étire, le noiraud granuleux penchez dangereusement. Ne souriez pas, madame, il pourrait se décrocher et tomber au fond de votre verre. Ne respirez pas non plus, il pourrait être aspiré au fond de votre narine et boucher le canal fronto-nasal. »